intro
Euphémisation de la violence faite aux lcouteurs.ices du breton
Dans le grand public, on sait que le breton dans la société française est plutôt perçu comme une langue du passé (c’est le cas de toutes les langues régionales) ; on sait aussi que le breton a longtemps été méprisé et exclu des institutions publiques (écoles, médias publiques) et on veut bien accepter qu’un mouvement culturel qui tente de rétablir donner à la langue bretonne une légitimité dans la société française.
Cependant tous les termes employés ci-dessus sont très euphémiques par rapport à la réalité vécue par ceux et celles qui parlent le breton et qui ont été pris.es, à certains moments de leur existence, dans des situations de violence (symbolique et incarnée) parce que, justement, ils ou elles parlaient breton.
Un seul exemple : le témoignage de Jean L. que j’ai rencontré en mai 2019. Quand il fait sa première rentrée à la fin des années 1940, à l’école de Plouguerneau (école catholique), il a 6 et 7 ans et il est monolingue en breton. Évidemment, il est perdu dans ce lieu où les maîtres parlent français et l’obligent à parler dans cette langue qu’il ne connaît pas. Pour lui faire bien comprendre que le breton est interdit dans l’école, quand les maîtres le surprennent à parler breton, ils le punissent en lui frappant avec une règle sur le bout des doigts. Quand Jean L. me raconte ces évènements, il mime le geste des doigts tendus et frappés et la douleur qui en suit. Il me dit que les maîtres de son école n’étaient juste brutaux ; ils étaient cruels (kriz).
A-t-il parlé breton à ses enfants ? Bien sûr que non, cela aurait été leur transmettre un handicap. Sa position par rapport au breton aujourd’hui ? C’est une langue du passé qui ne sert à rien qui a sa place au musée, et c’est tout… Il parle de sa langue maternelle.
Voilà ici, donc un témoignage de cette violence faite aux brittophones en raison de leur langue. Et ici d’une violence faite à un enfant.
Cette violence étant dite, on peut dire quelques mots sur les mécaniques qui firent du breton une langue stigmatisée, dont les locuteurs.ices premiers se sont eux et elles même éloigné.es.
La langue bretonne longtemps exclue des institutions publiques
(commencer ici) L’effondrement du nombre de brittophones est la conséquence prévisible d’un certain nombre de facteurs qui ont touché l’ensemble des langues régionales de France car toutes les langues régionales ont toutes connu une érosion considérable de leurs effectifs edpuis un siècle.
D’abord, le breton a été exclu pendant des décennies des institutions publiques nationales d’éducation, de culture et de communication (médias)… Même si les choses se sont améliorées au fil du temps.
Education nationale et langue bretonne
Pour la Troisième république, le programme d’une éducation nationale exclue d’emblée les langues régionales. On site souvent la déclaration d’Anatole de Monzie, ministre de l’Instruction Publique (1925) : « Pour l’unité linguistique de la France, il faut que la langue bretonne disparaisse ».
Pour assurer cette mission, les enseignant.e.s des écoles publiques (souvent imité.e.s par ceux et celles des écoles privées) mettent en place dans les classes des dispositifs vexatoires et humiliants qui pousseront les enfants à ne plus parler breton à l’école. L’un d’eux restera comme un traumatisme dans la société bretonne, il s’agit du symbole : les enfants se surveillaient mutuellement, celui qui était surpris à parler breton se voyait remettre un objet, le symbole, et une punition était infligée en fin de journée au dernier détenteur de l’objet. Franch Broudig décrit ce procédé terriblement efficace dans toutes ses variétés délétères dans cet article : « Le symbole et les autres dispositifs d’exclusion de la langue bretonne de l’école » (Presses Universitaires de Rennes, 2024).
Il faut attendre le début des années 1951, pour que l’Éducation nationale s’ouvre très timidement aux langues régionales et donc au breton : la loi Deixone autorise l’enseignement facultatif du breton (hors cursus) ; puis en 1970, on peut se présenter à une épreuve de langue régionale… Au fil des ans, à force de lutte militante, le breton s’installe dans les écoles publiques de Bretagne. Cependant, on est loin d’une présence massive et instituée comme en témoigne le faible développement des filières bilingues français/breton au sein de l’Éducation nationale : les classes bilingues Div Yezh (Deux langues) réunissaient xxx élèves en 2024. C’est bien peu par rapport aux 567 376 élèves que comptaient l’académie cette année-là. Les sections bilingues de l’enseignement privé (Dihun) sont moins nombreuses encore : x élèves en 2024. Quant aux écoles de l’association Diwañ où tout se passe en breton, elles scolarisaient x élèves en 2024 (cependant le poids de Diwañ dans le paysage linguistique de la Bretagne va bien au-delà du nombre de ses élèves).

Chaînes publiques de radio et de télévision. Pour la radio, si aujourd’hui, il y a x heures de breton quotidien plus trois heures le weekend, sur l’antenne régionale de Radio France (Ici Breizh Izel), au moment de sa création en 1964, on ne diffusait qu’une seule émission en breton par jour : un résumé de l’actualité qui durait moins de deux minutes. Et pour la télévision publique, à la création de la chaine régionale en xxx, il y avait x minutes de breton par jour à l’antenne. Aujourd’hui : x minutes par jour plus trois heures le weekend.
Télévision, radio publiques et langue bretonne
La place de la langue bretonne dans les médias publics est très limitée, et elle est toujours incertaine.
Radio publique. Les émissions en breton sont émises sur les antennes régionales de la radiodiffusion publique. On n’entend peu de breton quand le système se met en place : 5 minutes de chronique hebdomadaire en 1964 ; cela s’améliore dans les années 1980 (5 heures par semaine) et l’offre d’émissions en breton s’est stabilisée autour de 6 heures par semaine, aujourd’hui.
Télévision publique. Comme pour la radio, le breton apparaît sur l’antenne régionale du réseau de télévision publique. Les débuts sont très timides : un flash d’informations en breton de 1 minute 30 secondes tous les vendredis en 1960 (plus un autre les mardis à partir de 1964). En 1971, s’ajoute une émission de 20 minutes tous les 15 jours… A force de petits pas, on arrive à une présence étriquée du breton de 1 heure 30 minutes par semaine sur l’antenne régionale du système publique de France TV.
Face à une offre publique très limitée, des radios associatives totalement en breton proposent des alternatives sérieuses et il y a du breton sur certaines chaînes de télévision privées régionales (voir partie suivante).
Défiance politique
Ce n’est pas surprenant de voir le breton si mal traité dans l’Education nationale, ainsi qu’à la radio et la télévision publiques parce qu’il y a une véritable défiance des responsables politiques français (qui fine, ce sont eux qui décident de la destinée de ces institutions publiques) vis-à-vis du breton et toutes les langues régionales. Au fil des décennies, ces responsables, parfois au plus haut niveau de l’état, ont multiplié les déclarations sans fard cette défiance de principe envers les langues régionales (donc du breton) :
- Emmanuel Macron, président de la République française (2024) : « Les langues régionales étaient un instrument de division de la Nation »
- D’autres
- Et pour finir, au lendemain de la Révolution française, Bertrand Barrère, membre du Comité de Salut public (1794) : « Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; […] et le fanatisme parle le basque. Cassons ces instruments de dommage et d’erreur « .
Je reconnais que je fais ici une présentation à charge du monde politique et du breton en France car il y a aussi des responsables qui portent un regard plus positif sur les langues régionales en particulier au niveau local ; pour le breton, on peut l’article de x à ce sujet… Mais il faut reconnaître qu’entre la culture globale de la défiance vis à vis des langues du breton et des langues régionales dans leur ensemble parmi le personnel politique en France et les manifestations de sympathie avec le projet de soutenir leur développement, c’est bien le premier mouvement qui l’emporte au niveau national.
Mépris
A cette défiance politique, s’ajoute un mépris culturel qui traverse (traversait, plutôt) toute la société française
- dans la culture savante ; quelques citations des auteurs classique (ceux qu’on apprend dans les écoles) ; Flubert ; Balzac ; hugio
- dans la culture populaire avec le terme emblématique qui au départ un t »erme de mépris à l’attention dzes bertons qui viennent toujours d’un plou-quelque chose et qui s’adresse désormais à toutes personnes un peu rustique et donc méprisable
Toutefois, cette vision méprisante appartient au passé car depuis des années (au monis les ann&ées 19+70), l’image de la bretagbe est devenu trous poisitve ; ce dont témopigne l’extraordinaire réussite du tourisme breton : 111 millions de nuitées en 2024 (oui, oui, 111 milions), pour un chiffre d’affaire de () soit x% du PIB régioanel et etant d’emploi
Mais, même si les représneant cutglurelels ont véritablement changé a la faveur de la bretagne, il n’ne reste pas moins que toutes les personnes que j’ai rencontrées m’ont parlé d’un mépris pour la Bretagne et la langue bretonne… et des efforts qu’elles ont faites pour ne plus être plouc.
Violence faite à ceux et celles qui parlent breton
Certes, le breton fait sa place à la télé, à la radio, et à l’école, certes, les représentations culturelles dans la société française ont nettement changé en faveur de la Bretagne, mais il n’en reste pas moins que toutes les personnes que j’ai rencontrées m’ont dit qu’elles avaient le sentiment que le breton et la culture bretonne était plutôt dévalorisée et m’ont parlé d’expériences de péjoration douloureuse.
En fait, tout ce dont je viens de parler dans les paragraphes ci-dessus relèvent de mouvements macro-sociaux, macro-culturels, mais au niveau individuel, ces mouvements se sont traduit par des violences faites aux personnes : le mépris d’une culture et d’une langue, c’est le mépris d’une personne qui appartient à cette culture et qui parle cette langue, c’est une violence faite personne à cette personne, un rapport de domination produit par les uns et subis par les autres… Ce dont nous allons parlé dans le paragraphe qui suit.
(Fin de la partie)
(à mettre ailleurs) Il n’y a plus en France, l’expression explicite d’une volonté de faire disparaitre les langues régionales et donc le breton du paysage linguistique national comme ça pu l’être par le passé ; aujourd’hui, on ne cherche pas à nuire à ces langues en tant que telles (on ne les présente plus comme des sous-langues) mais c’est juste que sur le plan institutionnel, seul le français est la langue de la république et si on reconnaît les langues régionales, ce n’est qu’au titre comme éléments du patrimoine culturel national ; mais de facto, que les projets de développement des langues régionales portés régulièrement par des hommes et femmes se heurtent toujours à ce mur institutionnel : aucun de ces ne doit porter atteinte à la primauté du français ; à ce titre, l’enseignement des langues régionales par immersion comme c’est le cas à Diwan, dans les Calendretas, est structurellement fragile et potentiellement ce choix pédagogique ppurrait être remis en cause à tout moment parce que cela fait de ces écoles des lieux où le français n’a pas la primauté institutionnel. L’inégalité de statu des langues n’interdit pas l’usage des langues régioanles mais en limite considérablement les possibilités de développement.
fait que le développement s droits de l’en; ce n’est pas eut être toutcontestable )c’est la raison pour laquelle les projets de développement de faire reconnaître s filières au statut développement les langues régionales ne doivent entrer en concurrence in fine, cela veut dire comme patrimoine de la nation ; compte tenu ; il y a eu cette expression au début du XXviolence… qu’elles resentent , e ezhes soudu désir
s et in fine, ce sont eux qui décident de la destinée de ces institutions publiques.
eà la tête de la télévisiones médias publics Sur le plan politique, le breton, en fait toutes les langues régionales sont avec défiance par les autorités nationales. Du début de l’ère moderne jusqu’à aujourd’hui, les autorités politiques déclarent leur défiance vis-à-vis des langues régionales et leur envie de les rayer du paysage national. Quelques déclarations emblématiques : »Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; […] et le fanatisme parle le basque. Cassons ces instruments de dommage et d’erreur « . Bertrand Barrère, membre du Comité de Salut public (1794)
fzer : « » »
« Pour l’unité linguistique de la France, la langue bretonne doit disparaître ». Albert de Monzie, Ministre de l’Instruction (1925)
To,
on ne comptait qu’un peu publique : en 1964, une antenne régionale du réseau publique se met en place en Bretagne ; la place du breton y est réduite à un flash d’information de moins de deux minutes. En 1971, on ajoute une émission en breton de 15 minutes tous les quinze jours… Il faudra attendre de nombreuses avant d’attendre l’offre publique actuelle où, sur l’antenne régionale de Radio France (Ici Breizh Izel), une heure et demi d’émissions en breton.
Télévision publique
Et sur Il n’existe pas de chaînes brittophones ou au moins bilingue. Aujourd’hui, pour l’ine ni réduite élmédias publiques, il n’y a aucune chaîne véritablement bilingue, encore moins brittophone sur le réseau publique de radio et de télévision nationale ; il y a des émissions en breton sur les antennes régionales de Radio France et de France TV mais cette offre est limitée et elle est sans commune mesure avec le traitement des langues celtiques cousines du breton au Pays de Galles (chaîne de la BBC 100% en gallois) et en Irlande.
A cela s’ajoute une vision patrimoniale voire folklorisante du breton (plus globalement de la culture bretonne) qui fait obstacle à son développement et à une normalisation de son usage dans la société française, à tout le moins en Bretagne… Sans compter, la méfiance sur la loyauté des locuteurs et les promoteurs de la langue : » », disait le Président Emmanuel Macron.
Les personnes que j’ai interrogées ont toutes témoigné de la violence du rejet de leur langue maternelle dans la société française ; avec une expérience traumatique récurrente : l’interdiction de parler le breton sanctionnée par des punitions humiliantes voire des châtiments corporels.
Dans les conditions décrites ci-dessus, l’érosion du breton dans la société bretonne était à peu près certaine.
Mépris culturel et défiance politique
- « Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; […] et le fanatisme parle le basque. Cassons ces instruments de dommage et d’erreur « . Bertrand Barrère, membre du Comité de Salut public (1794)
- fzer : « » »
- « Pour l’unité linguistique de la France, la langue bretonne doit disparaître ». Albert de Monzie, Ministre de l’Instruction (1925)
- « Les langues régionales étaient un instrument de division de la Nation », Emmanuel Macro, Président de la République (2024)
- To,
, dans les premiers temps de la Révolution française, tout va bien : les décrets de la République sont traduits dans les langues autochtones ; sans ça, de toute façon, ils seraient incompris de citoyen.nes totalement monolingue dans leur maternelle non française. Mais après des mouvements de révolte dans les Provinces, les institutions politiques ne sont plus du tout favorables aux langues régionales. Bertrand Barère, membre du Comité de Salut public déclare » Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; l’émigration et la haine de la République parlent allemand ; la contre-révolution parle l’italien, et le fanatisme parle le basque. Cassons ces instruments de dommage et d’erreur « . ‘attitude se radicalisent ifférents ieises modere
Ajouter un petit paragraphe sur l’aspect institutionnel de l’exclusion
Retour au menu de « Langue bretonne : présentation »
Dynamisme du mouvement breton
La société bretonne n’est pas restée passive ; un mouvement culturel de grande ampleur s’est installé durablement dans le paysage. En plusieurs vagues, ce mouvement (Emsav, l) a défendu et développé le breton et créé dans cette langue.
Aujourd’hui, un tissu associatif a suppléé au manquement de la puissance publique dans le domaine des médias (radios brittophones, chaînes de télévision brittophones sur le web, journaux et revues), des écoles bilingues (Diwañ), formation continue (Roudour),…
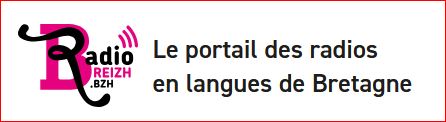
Du côtés des entreprises privées de médias, des chaînes de télévision existent qui donnent une place à des émissions et à la création en breton ; en particulier les chaînes TBO et Tébésud du groupe Télégramme.
La littérature bretophone du vingtième et d’aujourd’hui n’a pas à rougir de ces productions, avec des personnalités comme Per Jakez Elias, Añjela Duval qui lui ont donné une visibilité nationale et internationale incontestable.
Du côtés des entreprises des médias, des chaînes de télévision privée existent qui donnent une place à des émissions et à la création en breton ; en particulier les chaînes TBO et Tébésud du groupe Télégramme. Et il faut citer l’expérience malheureuse de TV Breizh qui aujourd’hui, est une chaîne de télévision sans âme qui diffuse des séries américaines, mais qui au moment de sa création a donné chair au breton sous l’impulsion Rozenn Milin, elle même brittophone.
Breton populaire, breton des clercs : la rupture
Et il faut aussi dire un mot du travail de modernisation et de codification de la langue bretonne qui a été mené depuis la fin du XIXième siècle par les écrivains, les linguistes breton.nes. Il était difficile de standardiser une langue aux variétés dialectales si fortes ; in fine, leurs travaux a abouti une forme standard qui s’est imposé dans les institutions, le peurunvan.
Mais l’adhésion au peurunvan n’est pas unanime parmi les clercs de la langue bretonne qui ont œuvré à son développement. Il y a d’autres propositions : ar skolveurieg (l’universitaire), an etrerannyezhel (l’interdialectale). En outre, le peurunvan est accusé par ses détracteurs d’avoir été porté par des sympathisants de l’occupant allemand pendant la Seconde guerre mondiale.
Malheureusement, de son côté, le peuple des bretonnant.es (puisque c’est comme ça qu’iels s’appellent) a d’autant moins adopté ce peurunvan qu’iels ne le comprenaient pas toujours. C’était comme une variété dialectale nouvelle du breton qui aurait nécessité un moment de familiarisation pour la comprendre… Cela ne s’est pas fait. Dans une certaine mesure, il n’est pas faux de dire que les bretonnant.es ordinaires ont été exclu.es de la modernisation de leur langue maternelle.
Alato, n’eo ket echu c’hoazh (Enfin, ce n’est pas encore fini)
J’ai bien conscience de dresser un portrait attristant de très joyeux de la situation du breton… C’est excessif. Je fais partie de cette longue liste qui annonce la fin de la langue bretonne… Si je fais, ce site, c’est que je ne me crois pas.
La suite :